Concert Aïda du 10 octobre
PROGRAMME
En cette année des 150 ans de Maurice Ravel, Jonathan Nott, le futur directeur musical du Liceu de Barcelone interprète un répertoire qui lui tient particulièrement à cœur et invite la violoniste Leticia Moreno à briller dans l’irrésistible Symphonie espagnole d’Edouard Lalo.
Edouard LALO (1823-1892)
Symphonie espagnole (1874)
1. Allegro non troppo
2. Scherzando : Allegro molto
3. Intermezzo : Allegretto non troppo
4. Andante
5. Rondo : Allegro
Durée : 30 minutes
Maurice RAVEL (1875-1937)
Valses nobles et sentimentales (1911)
Durée : 16 minutes
Maurice RAVEL (1875-1937)
La Valse (1920)
Durée : 13 minutes
DISTRIBUTION
Jonathan NOTT, direction
Leticia MORENO, violon
Orchestre national du Capitole
BIOGRAPHIES
Leticia Moreno

Née en Espagne, la violoniste d'origine péruvienne, Leticia Moreno s'est d'abord faite connaître en remportant les concours internationaux les plus prestigieux, notamment les Concours Szeryng, Concertino Praga, Novosibirsk, Sarasate et Kreisler.
Leticia Moreno a collaboré avec des chefs d'orchestre tels que Zubin Mehta, Gustavo Dudamel, Esa-Pekka Salonen, Paavo Järvi, Vladimir Ashkenazy, Christoph Eschenbach, Yuri Temirkanov, Krzysztof Penderecki et Peter Eötvös. A ces occasions, elle s'est produite avec l'Orchestre symphonique de Vienne, le Philharmonique de Los Angeles, le Philharmonia Orchestra de Londres, le Mahler Chamber Orchestra, le National Symphony Orchestra de Washington, l'Orchestre du Mariinsky et le Philharmonique de Saint-Pétersbourg, l'Academy of St Martin in the Fields, le China NCPA Orchestra, tout en étant régulièrement invitée par les principaux ensembles symphoniques d'Espagne.
En musique de chambre, Leticia Moreno a collaboré avec Sol Gabetta, Bertrand Chamayou, Kirill Gerstein, Alexander Ghindin, Lauma Skride, Mario Brunello, Leonard Elschenbroich, Ksenija Sidorova et Maxim Rysanov.
Au cours de la saison 2025/26, Leticia Moreno présentera son projet de musique de chambre « Bach in the Jungle », qui explore les liens entre la musique de Bach et les traditions d'Amérique du Sud, au Festival Enescu et au Festival Montreux-Vevey. Parmi les autres temps forts de cette saison, elle reprendra Aurora du compositeur péruvien Jimmy López Bellido avec l'Orchestre symphonique de Tenerife et Pablo González, une œuvre qu'elle a créée en 2022. Elle se produira également avec l'Orchestre symphonique de Singapour, avec l'Orchestre de chambre de Berlin et l'Orchestre symphonique national du Pérou.
Sa discographie comprend un album « Piazzolla », paru chez Deutsche Grammophon et enregistré aux studios Abbey Road ainsi qu'au studio Emil Berliner ; « Spanish Landscapes » et le Concerto pour violon n° 1 de Chostakovitch.
Leticia Moreno a reçu en 2012 le Premio Princesa de Girona Artes y Letras, décerné par Leurs Majestés le Roi et la Reine d'Espagne.
Elle joue sur un violon Nicola Gagliano de 1762.
Jonathan Nott

Le chef d'orchestre britannique Jonathan Nott est directeur musical de l'Orchestre de la Suisse romande, directeur musical de l'Orchestre symphonique de Tokyo, chef principal et conseiller artistique de la Junge Deutsche Philharmonie, l'un des principaux orchestres de jeunes en Allemagne. Il vient d’être nommé directeur musical du Gran Teatre du Liceu à Barcelone pour une durée de cinq ans, à partir de septembre 2026.
Jonathan Nott a précédemment été directeur musical de l'Opéra de Lucerne et de l'Ensemble Intercontemporain, et chef principal de l'Orchestre symphonique de Lucerne et de l'Orchestre symphonique de Bamberg.
Parmi ses projets récents, citons la production de Saint-François d'Assise de Messiaen mise en scène par Adel Abdessemed à Genève, la Symphonie n°7 de Mahler avec le New Japan Philharmonic, deux concerts avec l'Orchestre philharmonique de Berlin dans des œuvres de Mazzoli, Eötvös et Ives, et une tournée en Allemagne aux côtés de la Junge Deutsche Philharmonie.
En 2025, Jonathan Nott a dirigé le gala d'opéra du Nouvel An avec l'Orchestre de la Suisse romande, puis il s'est produit en tant que chef invité avec l'Orchestre symphonique de la SWR, l'Orchestre symphonique de la WDR de Cologne, la Philharmonie de Dresde et l'Orchestre de la Tonhalle de Zurich. Il a également dirigé dans le cadre du Festival de Tokyo et lors d'une tournée en Asie avec l'Orchestre de la Suisse romande.
Avant de se consacrer pleinement à la direction d'orchestre, Jonathan Nott a étudié le chant à l'université de Cambridge et au Royal Northern College of Music, se produisant comme ténor avec les chœurs de Saint-Paul et de la Cathédrale de Westminster. Il a étudié la direction d'orchestre avec David Parry et il a été répétiteur au London Opera Studio.
Il a ensuite occupé des postes d'importance dans des opéras en Allemagne. Comme premier chef à Wiesbaden, il a dirigé des œuvres de Cimarosa, Mozart, Rossini, Verdi, Gounod, Puccini, Chostakovitch, Kurt Weill, Maxwell Davis, Henze, Prokofiev, Wagner et Strauss. À Francfort, il a travaillé sur plusieurs pièces contemporaines de Ligeti (en particulier la première hongroise du Grand Macabre), Boulez, Stockhausen, Lachenmann, Hosokawa, Eötvös, Gubaidulina et des compositeurs de la jeune génération.
Jonathan Nott est par ailleurs maître Reiki.
Sa discographie comprend des œuvres de Ligeti avec l'Orchestre philharmonique de Berlin, de Mahler avec l'Orchestre philharmonique de Vienne, de Janacek, Bruckner et Wagner avec l'Orchestre symphonique de Bamberg, ainsi que l'intégrale symphonique de Schubert et Mahler. Ces enregistrements ont été couronnés par de nombreuses récompenses, le prix international Toblacher Komponierhäuschen 2009, le prix Midem du meilleur disque classique 2010 et le Choc de Classica en 2022. Sa discographie avec l'Orchestre symphonique de Tokyo, parue sous le label Exton/Octavia, inclut des œuvres de Mahler, Bruckner et Tchaïkovski et, tout récemment, de Beethoven (symphonies n°2 et 5) et Brahms (Symphonie n°2).
PRÉSENTATION DES ŒUVRES
Edouard LALO (1823-1892)
Symphonie espagnole (1874)
Le terme choisi par Edouard Lalo pour intituler cette pièce nous tend un sacré piège ! Derrière le nom de son œuvre la plus célèbre - avec son opéra Le Roi d’Ys – se cache en effet non pas une symphonie mais plutôt un concerto ! En effet l’orchestre n’est pas le héros de cette œuvre puisque ce dernier a pour mission de mettre en lumière un violon soliste. Composée un an après un précédent - et clairement nommé celui-ci - Concerto pour violon op.20 (1873), la Symphonie espagnole est, en réalité et pour être tout a fait exact, un mélange, savant et savoureux, du concerto et de la symphonie, ce qui la classe dans le genre très populaire en France au 18e siècle de la « symphonie concertante » au même titre que l’œuvre de Berlioz Harold en Italie, composée pour alto et orchestre. L’aspect « symphonie » de l’œuvre provient du découpage en cinq mouvements au lieu des trois réglementaires du concerto. En revanche, Edouard Lalo ne cherche pas à fondre le violon dans l’orchestre mais bel et bien à le mettre en valeur et à le placer systématiquement au premier rang du discours musical. Dans une lettre du 27 octobre 1879 citée par Gilles Thieblot dans une remarquable biographie consacrée au compositeur, Edouard Lalo écrit à propos du Concerto pour violon de Brahms qu’il n’apprécie guère : « Je maintiens que lorsqu’on place un soliste sur une estrade, il faut lui donner le premier rôle, et non le traiter comme un simple instrument de l’orchestre. Si le genre solo déplait au compositeur, qu’il écrive des symphonies, ou toute autre chose pour l’orchestre seul, mais qu’il ne m’ennuie pas avec des bouts de soli constamment interrompus par l’orchestre, et naturellement beaucoup moins intéressants que ce que l’orchestre vient de dire ».
Ces mots qui placent le violon sur le devant de la scène sont adressés à un autre détracteur du Concerto de Brahms. Il s’agit du créateur de la Symphonie espagnole de Lalo, un violoniste star du 19e siècle : Pablo de Sarasate. D’origine espagnole, comme Edouard Lalo, c’est lui qui donne tout le lyrisme à cette œuvre au milieu d’évocations de rythmes, de gammes et de timbres ibériques comme en attestent notamment la présence d’un triangle, d’un tambour de basque ou encore de cordes jouant au doigt comme une grande guitare imaginaire, quelques habanera et séguedilles qui en appellent d’autres… Celles de Carmen, un opéra espagnol de Georges Bizet créé un mois après la Symphonie espagnole d’Edouard Lalo, le 3 mars 1875 à l’Opéra-Comique.
Maurice RAVEL (1875-1937)
Valses nobles et sentimentales (1911)
Quatre jour après la naissance de Carmen, c’est un autre faiseur de tube et amoureux de l’Espagne qui voit le jour. Le 7 mars 1875 à dix heures du soir dans un bel immeuble en pierre et de style hollandais naît un petit Basque nommé Maurice Ravel. On peut aujourd’hui visiter sa maison natale, à Ciboure, une bâtisse au passé glorieux qui a accueilli des personnalités illustres comme Mazarin, qui y séjourna à l'occasion du mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse d’Autriche. De l’avis du compositeur, la famille de Ravel est, quant à elle, beaucoup moins noble : « Pour ce qui est de mon arbre généalogique, l’essence est si complexe que je n’ai jamais eu le temps de l’analyser. Ma mère est née à Ciboure, d’une famille de marins, comme presque tous les Basques de la côte. Il a dû y avoir de tout ; des capitaines au long cours jusqu’à de simples pêcheurs. La plupart de ces ancêtres sont partis pour les Amériques et n’en sont jamais revenus. » Peut-être que ses aïeuls n’avaient jamais entendu parler de Franz Schubert, de ses Valses nobles D.969 et de ses Valses sentimentales D. 779 écrites en 1823 et qui servent de modèle à ces pièces pour piano puis orchestre signées Maurice Ravel. Il est bien difficile pourtant de déceler dans ces pièces une quelconque parenté de style avec le romantisme du Viennois. En revanche, lors de la création de l’œuvre au piano le 8 mai 1911, on a pu rapprocher ces pièces du style grinçant d’un Erik Satie ! C’est pourtant bien Ravel qui se cachent derrière ces huit valses orchestrées en 1912 afin d’être intégrée à un ballet intitulé Adélaïde ou Le langage des fleurs. Un Ravel léger, qui s’amuse dans la première valse, nous tire une larme dans la deuxième et nous invite à apprécier, comme le suggère le vers d’Henri de Régnier placé en exergue de la partition « le plaisir délicieux et toujours nouveau d'une occupation inutile ».
Maurice RAVEL (1875-1937)
La Valse (1920)
Il y a les valses et puis il y a… La Valse. Celle-ci, n’est ni noble, ni sentimentale. Ou plutôt, disons qu’elle a perdu au fil des années, des traumatismes et de sa gestation tout ce qu’elle aurait dû porter de noblesse et de lyrisme… En 1906, quelques années avant d’écrire ses Valses nobles et sentimentales, Maurice Ravel est approché par Serge de Diaghilev, le grand impresario et directeur des Ballets Russes pour concevoir une grande valse orchestrale pouvant être jouée par sa troupe installée à Paris. Au départ, le musicien pense à un modèle tout trouvé et désire composer un hommage au style de Johann Strauss fils, le roi de la valse viennoise, cette danse à trois temps qui affole depuis plusieurs années la noblesse européenne. Mais quand ils ne dansent pas, les puissants de ce monde ont parfois des idées funestes. Les palais et les valses s’éloignent quand Ravel, comme des millions d’Européens se retrouvent sur la ligne de feu à attendre une fin heureuse ou triste. Engagé volontaire en tant que conducteur d’une ambulance qu’il surnomme Adélaïde, Ravel déchante. Un fois revenu de son Voyage au bout de la nuit, il change d’avis et compose en 1919, une œuvre bien différente. Comme l’Europe, coupée en deux par la grande hache de l’Histoire, sa valse a aussi les jambes tranchées. Impossible de danser sur cette ronde malade, ivre, bancale, introduite par des grondements dans l’extrême grave des contrebasses et d’un contrebasson d’outre-tombe. Dans cette page spectaculaire en forme de vaste crescendo, des épisodes d’une valse apparaissent épisodiquement mais ces élans sont en permanence interrompus et brisés par un orchestre violent qui transforme la sensualité des valses viennoises en une série de rires macabres. Cette partition que Ravel décrivait comme étant une « espèce d'apothéose de la valse viennoise à laquelle se mêle dans mon esprit l'impression d'un tourbillon fantastique et fatal » est-elle l’expression de la décadence « fin de siècle », d’une dernière danse au bord d’un volcan, ou bien le ballet spectral et sans lustre de toute une génération sacrifiée ?
Max Dozolme
Retour
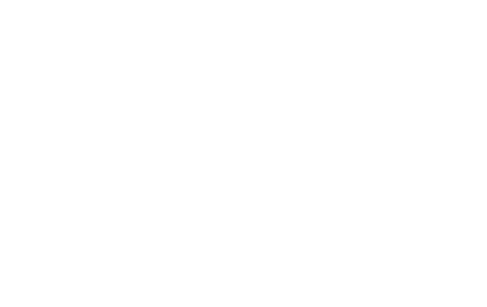
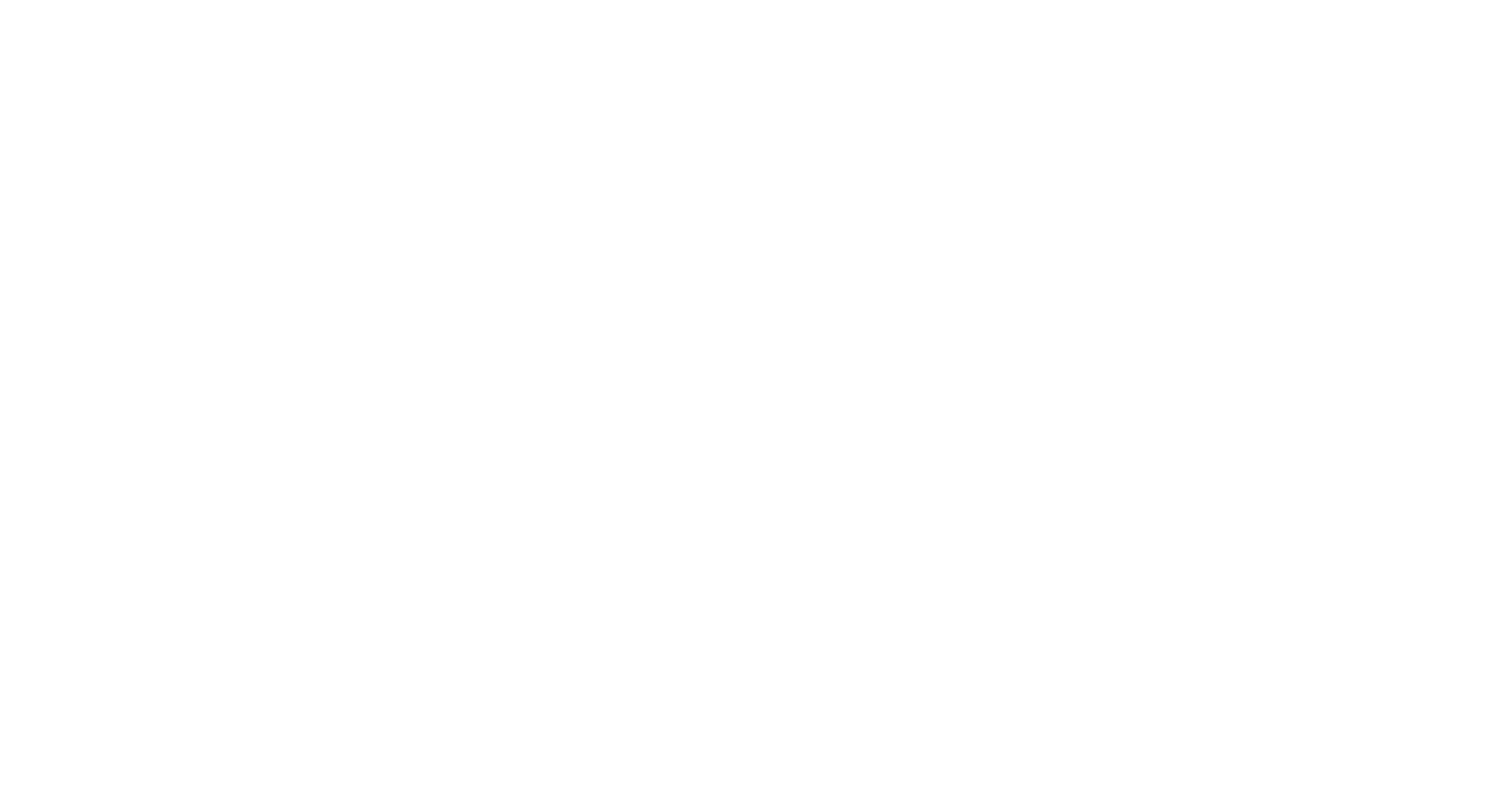
 par
par